Fédéralisme et relations extérieures aux États-Unis : mieux comprendre les actions des États
EARL FR Y
En 1787, les Pères fondateurs des États-Unis d’Amérique ont dû se réunir à Philadelphie parce que la Constitution d’origine, appelée « Articles de Confédération », avait confié aux États la majeure partie de l’autorité et qu’à peine née la nation commençait déjà à se déliter sous les coups de ses treize unités constituantes. De fait, les États s’étaient lancés dans leur propre diplomatie internationale et partaient souvent du principe que leurs intérêts particuliers devaient prendre le pas sur l’intérêt général de la confédération. Quelque 220 années plus tard, nous pouvons constater que la majorité des États et même quelques grandes municipalités sont encore une fois bien présents sur la scène internationale. Les États gèrent actuellement quelque 180 bureaux à l’étranger et, année après année, la plupart des gouverneurs prennent la tête de délégations en mission à l’étranger.
Le fédéralisme, et la manière dont il organise les relations extérieures des États-Unis à l’époque contemporaine, comporte des implications s’étendant bien au-delà des frontières américaines. En leur qualité de
54 Earl Fry
seule et unique hyperpuissance planétaire, les États-Unis font sentir leur influence jusque dans les endroits les plus reculés du globe. La colossale économie américaine représente plus de deux fois sa suivante immédiate, le Japon. Et si l’on passe aux États, trois d’entre eux – la Californie, New-York et le Texas – auraient, en 2003, pris place au nombre des dix premières nations du monde en termes de produit intérieur brut (PIB) ; vingt-deux d’entre eux feraient partie des vingt-cinq premiers États-nations ; trente-huit, des cinquante premiers ; et tous les cinquante parmi les soixante-douze principales puissances du monde. Sans aucun doute, les États peuvent être considérés comme des acteurs économiques majeurs sur la scène mondiale.
Les autorités des États ont traditionnellement considéré qu’il leur appartenait de se consacrer à la promotion et à la défense des intérêts de leurs citoyens. Cette mission est cependant devenue sensiblement plus difficile en raison de la mondialisation et de ce que l’on a coutume d’appeler « destruction créatrice » – terme qui désigne le processus de disparition de secteurs d’activité conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Reflet de la mondialisation, quelque dix-huit millions d’emplois aux États-Unis dépendent aujourd’hui des exportations, des investissements directs en provenance de l’étranger et du tourisme étranger. Tous les États convoitent une partie de ce pactole et font en sorte que leur propre communauté commerciale se montre compétitive à l’échelle mondiale. Les dirigeants des États perçoivent également tout le bénéfice qu’ils peuvent retirer de l’ouverture de leurs propres bureaux à l’étranger et du financement de missions économiques internationales périodiques, plutôt que de se satisfaire de la promotion collective des intérêts des États opérée outre-mer sous l’égide des ambassades et des consulats américains.
Les États souhaitent également se trouver du bon côté de la destruction créatrice. Chaque année aux États-Unis, quelque 600 000 entreprises ouvrent leurs portes, mais il y en a presque autant qui les ferment. Plus de trente millions de nouveaux emplois sont créés dans le même laps de temps, mais environ trente autres millions sont perdus. Silicon Valley peut certes symboliser une réussite insolente à l’échelle de la destruction créatrice, mais les communautés liées aux anciennes économies capitalistes comme Detroit, Newark et Saint-Louis ont dû lutter pour leur survie. Les États ont compris que les circonstances mondiales peuvent influer sur leur réussite économique aussi bien que les conditions nationales, et ils ont réagi en s’engageant plus sur le plan international.
Le fédéralisme américain se trouve désormais confronté à plusieurs défis. Le premier consiste à distinguer entre affaires étrangères et politique extérieure. Washington n’a pas montré trop d’inquiétudes face à l’enga-gement des États dans l’économie internationale, leur établissement de liens spéciaux avec d’autres gouvernements régionaux à l’étranger, ou même le renforcement de relations internationales dépassant la simple portée économique. Pourtant, le gouvernement national ne veut pas que les
États-Unis d’Amérique
États se mêlent de politique extérieure. Quelques incidents en la matière méritent d’être signalés, comme les sanctions unilatérales du Massachussetts à l’encontre du Myanmar (ex-Birmanie) et les sanctions actuellement prises par l’Illinois contre le Soudan. Washington rappelle que selon la Constitution la politique extérieure reste l’apanage du gouvernement national et que la nation se doit de « parler d’une seule voix »
dès que d’importantes questions de politique extérieure sont en jeu.
Le deuxième défi est représenté par le sentiment que les pouvoirs régionaux s’érodent, conséquence des obligations imposées par les traités internationaux auxquels souscrivent les États-Unis. Dans les États, nombre d’officiels estiment que les engagements américains vis-à-vis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’Association de libre-échange nord-américaine (ALENA) et d’autres organisations ont dépouillé les États d’une partie des compétences que la Constitution des États-Unis leur garantissait. Cela se vérifie tout particulièrement dans le chapitre 11 de l’ALENA, qui limite les interventions des États destinées à protéger l’environnement et la santé de leurs citoyens.
Le troisième défi tient aux carences de la
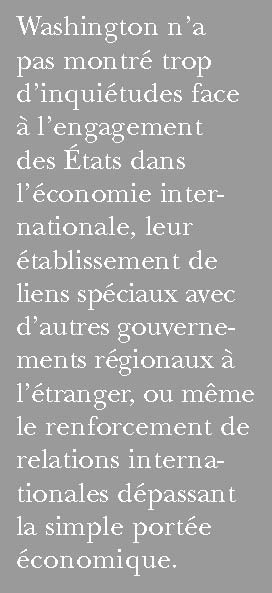
coopération intergouvernementale quand il s’agit d’affronter les effets de la mondialisation et de la destruction créatrice. Ainsi, les représentants des États se plaignent qu’ils auraient besoin de statistiques précises sur les exportations et les importations au niveau local, mais qu’en fait Washington tend à restreindre la collecte de ces données plutôt qu’à y ajouter des ressources. Les mêmes ajoutent qu’il n’existe pas de réel dialogue avec Washington sur des questions comme le chapitre 11, et que les consultations menées avec les États avant que le gouvernement national ne s’engage dans un traité international sont inadéquates.
Le quatrième défi concerne tous les ordres de gouvernement, et il consiste pour eux à s’engager dans une collaboration plus efficace entre secteurs public et privé. Les États-Unis font bien moins qu’ils ne le pourraient dans le domaine des exportations et la plupart des entreprises ne songent même pas à vendre leur production à l’étranger. Les États et les collectivités locales sont mieux équipés pour collaborer avec les petites et moyennes entreprises à l’échelle locale et pour établir des infrastructures de classe mondiale, y compris des systèmes d’éducation nettement plus performants, capables d’aider ces entreprises à produire des biens et des services compétitifs à l’échelle mondiale, puis à les exporter.
56 Earl Fry
Le cinquième défi se pose à tous les systèmes fédéraux. Le fédéralisme représente-t-il un avantage ou un inconvénient quand il s’agit de faire face aux exigences de la mondialisation et de bouleversements technologiques sans précédent ? Les systèmes unitaires sont-ils mieux équipés pour s’adapter rapidement et de manière uniforme aux nouvelles normes internationales ? Aux États-Unis, certains États pratiquent encore une forme de protectionnisme local susceptible de décourager les investisseurs étrangers. Ces derniers préféreraient à coup sûr que les activités économiques soient réglementées par une seule législation plutôt que par cinquante lois régionales auxquelles vient encore s’ajouter une loi nationale. Les points de vue des États sur les principales questions internationales peuvent en outre varier considérablement. Au bout du compte, dans un pays où 300 millions d’habitants se partagent le quatrième plus grand territoire du monde, le fait de confier aux États et aux collectivités locales un rôle plus important dans les affaires étrangères est-il de nature à profiter au citoyen américain moyen ?
Le dernier défi concerne les États, qui doivent envisager sur le long terme les activités qu’ils entendent entreprendre sur la scène internationale. Les États ont ouvert aujourd’hui 180 bureaux à l’étranger, contre 4 en 1980, ce qui paraît impressionnant. Et pourtant, en 2002, ils en avaient 243 dans trente pays, ce qui rappelle à quel point cette question dépend des caprices du gouverneur en place. La plupart des programmes mis sur pied par les États n’ont pas réussi à se projeter sérieusement dans le long terme, une situation qui contraste fortement avec les moyens et les projets des principales provinces du Canada. Certes, les États peuvent faire valoir le célèbre aphorisme « penser globalement, agir localement », mais jusqu’à présent leurs incursions dans le domaine des affaires étrangères des États-Unis sont demeurées sporadiques et largement dépourvues de vision à long terme et de permanence institutionnelle.
